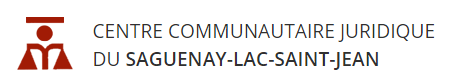Jacques, qui travaille comme mécanicien, cohabite avec son amie Louise, sans emploi et prestataire du Programme d’aide sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pour Jacques, c’est une situation avantageuse puisque sans être sa conjointe au sens propre, Louise est agréable et serviable, en plus de contribuer aux charges communes du logement.
Un jour, Jacques reçoit par la poste un avis de réclamation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lui réclamant la somme de 35 000 $. Bien qu’il n’ait jamais demandé d’aide financière, un numéro de dossier est attribué à son nom. Jacques tente de régler cette situation, qu’il considère comme une erreur, avec l’agent du ministère, mais en vain. N’ayant pas un revenu annuel très élevé et sous les conseils d’un ami, Jacques rencontre un syndic de faillite qui lui recommande de faire cession de ses biens (faillite), afin de « repartir à zéro ».
Quelques années s’écoulent et Jacques, libéré de sa faillite, est maintenant retraité. C’est à un certain moment qu’il constate qu’il ne reçoit plus les montants normalement versés pour sa pension de la Sécurité de la vieillesse dans son compte. En même temps, Jacques reçoit à nouveau des relevés de compte du même créancier, soit le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pourtant, la dette avait été admise dans la faillite. Il ne comprend pas pourquoi on lui réclame toujours le montant, le syndic lui ayant dit qu’il serait libéré de ses dettes. Il consulte alors un avocat et c’est à cet instant qu’il comprend l’ampleur de la gravité de la situation.
La réclamation n’ayant jamais été contestée par la voie légale, elle est présumée valide, et ses recours sont maintenant prescrits. Qui plus est, il s’agit d’une dette qui est exclue de la libération du failli, soit une dette résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits (art. 178 e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Qu’est-ce que cela veut dire? En faisant vie commune avec Louise pendant une période prolongée, Jacques aurait dû savoir qu’ils correspondaient à la définition de « conjoints » au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. L’article 22 dispose que sont notamment conjoints : « […] les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an. ».
Mais ils n’ont pourtant jamais été mariés. Les tribunaux (2022 QCTAQ 01548) ne voient pas le concept de vivre maritalement du même œil. Ce concept implique que deux critères doivent être obligatoirement rencontrés, soit la cohabitation et le secours mutuel. Quant au troisième critère, soit la commune renommée, celui-ci est supplétif afin d’appuyer les deux premiers critères, et ce, dans le but de confirmer la vie maritale.
Ultimement, Jacques aurait pu contester sa connaissance des déclarations de Louise afin de s’exonérer de sa responsabilité solidaire (encore faut-il qu’il en fasse la preuve), ce qu’il a omis de faire en ne consultant pas un professionnel du droit.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau d’aide juridique le plus près de chez vous, où l’un de nos avocats répondra à toutes vos questions.